
L’accord qui n’a jamais eu lieu : Washington l'a proposé, Moscou l'a accepté, mais Trump l'a bloqué
L’accord qui n’a jamais eu lieu révèle comment la diplomatie transactionnelle de Trump – de Séoul à Anchorage – a transformé une opportunité tangible de paix en une nouvelle occasion manquée.
Le plan proposé – une sorte d’"Istanbul Plus" – avait été formulé par Washington, puis brusquement abandonné. Depuis l’interview révélatrice de Lavrov, que nous analysons ci-dessous, jusqu’à l’échec du sommet d’Anchorage, l’histoire montre comment un plan de cessez-le-feu initié par les États-Unis en Ukraine a échoué, laissant la Russie sceptique, gelant les canaux diplomatiques et exacerbant les tensions militaires.
C’était une occasion unique qui aurait pu changer le cours de la guerre et renforcer la crédibilité internationale de Washington – mais elle n’a pas été saisie, illustrant comment des calculs politiques à court terme peuvent détruire des perspectives de paix à long terme.
Le schéma transactionnel de la diplomatie trumpienne
Le président Donald Trump s’est récemment rendu en Corée du Sud, où il a reçu les honneurs officiels et négocié un nouvel accord commercial. Selon plusieurs rapports, Trump aurait accepté de réduire les tarifs douaniers américains sur les exportations sud-coréennes en échange de la promesse de Séoul d’investir environ 350 milliards de dollars aux États-Unis.
Cet accord illustre bien la tactique habituelle de Trump : imposer des tarifs écrasants, obtenir d’énormes promesses d’investissement – puis lever les tarifs. Il a appliqué la même stratégie à l’Union européenne, au Japon et à d’autres partenaires, tandis que la Chine a résisté et riposté. Cette approche ressemble moins à une politique protectionniste cohérente qu’à un système d’extorsion des années 1920, plus proche des méthodes mafieuses que de la diplomatie moderne. Beaucoup doutent que les investissements promis se concrétisent un jour, et la Cour suprême des États-Unis doit examiner la constitutionnalité de la stratégie tarifaire de Trump, largement considérée comme une diplomatie coercitive plutôt qu’une politique économique saine.
Cette approche reflète les méthodes de Trump dans d’autres domaines, notamment dans ses relations avec la Russie. Lors du sommet d’Anchorage, l’émissaire de Trump aurait proposé un plan de paix pour l’Ukraine, que Moscou avait accepté. Mais Trump s’est ensuite rétracté, a formulé de nouvelles exigences, a publiquement dénigré Poutine et a ravivé les tensions en menaçant de sanctions et de déploiements de missiles. Ce schéma – fanfaronnade, mise en scène de « grands » accords, puis retrait – est devenu un trait caractéristique de sa politique étrangère et a gravement sapé la crédibilité des États-Unis aux yeux de nombreux observateurs internationaux.
L’analyste russe Dmitri Trenin, écrivant dans Kommersant – un journal largement lu dans les milieux d’affaires russes –, a décrit la perception évolutive de Trump à Moscou, estimant que des relations d’affaires substantielles entre la Russie et les États-Unis sont peu probables dans un avenir proche. Il dépeint le président Trump comme :
imprévisible et manipulateur, alternant entre menaces et séduction ;
motivé par la gloire personnelle plutôt que par une vision stratégique cohérente ;
économiquement prédateur, utilisant tarifs et guerres commerciales pour affaiblir ses rivaux ;
plus soucieux de l’image que du fond, privilégiant les « trêves » pour la photo aux paix durables.

Trenin conclut que la Russie n’attend plus de négociations substantielles avec Trump, ayant reconnu les limites de son véritable pouvoir au sein du système américain, à savoir l’État profond permanent. Néanmoins, l’engagement de Moscou avec Trump – la soi-disant « opération diplomatique spéciale » – a eu un objectif stratégique : signaler à des partenaires clés tels que la Chine, l’Inde et le Brésil que la Russie restait ouverte au dialogue et, en l’absence d’ingérence occidentale ou d’obstruction par le régime bandériste, intéressée par une résolution pacifique du conflit en Ukraine. Dans le même temps, cela a rassuré l’opinion publique russe sur la détermination de sa direction et renforcé la conviction que seul le succès militaire – et non la « diplomatie » coercitive, pilotée par les États-Unis – pouvait garantir les objectifs à long terme de la Russie en Ukraine.
L’interview de Lavrov : nouvelles révélations sur un plan de paix raté
Dans une récente interview accordée à une chaîne YouTube hongroise – la même que celle utilisée occasionnellement par le Premier ministre hongrois Viktor Orbán – le ministre russe des Affaires étrangères, Sergey Lavrov, a livré des informations sur les échanges diplomatiques entre les États-Unis et la Russie depuis le milieu de l’année. Ses déclarations ont permis de clarifier plusieurs incertitudes autour du sommet d’Anchorage et du sommet annulé de Budapest, offrant un rare aperçu de négociations qui auraient pu changer le cours de la guerre.
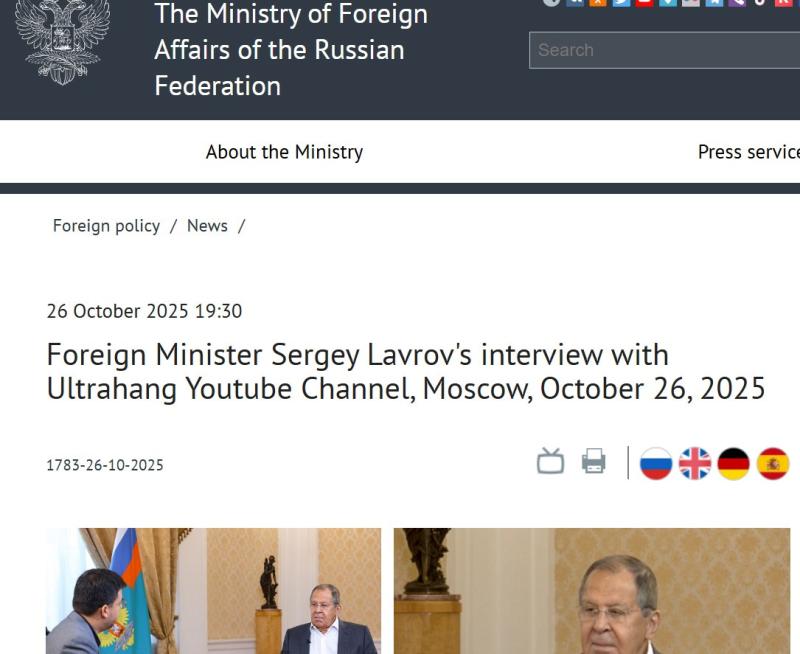
Le sommet d’Anchorage et la proposition américaine
Selon Lavrov, lorsque le président Vladimir Poutine s’est rendu en Alaska, un plan avait déjà été transmis à Moscou quelques jours plus tôt par l’envoyé de Trump, Steve Witkoff. Poutine a examiné en détail la proposition américaine, en présence de Witkoff, et a confirmé que Moscou était prêt à l’accepter – même si le plan était entièrement d’origine américaine.
La proposition envisageait un cessez-le-feu dans les régions de Zaporizhzhia et Kherson en échange du retrait de l’Ukraine du Donbass. Contrairement à de nombreux articles dans les médias occidentaux, il ne s’agissait pas d’une initiative russe pour la paix : c’était un plan américain, formulé et présenté par Washington.
L’effondrement de l’accord
Poutine s’attendait apparemment à ce que Trump confirme formellement l’accord lors de leur rencontre en Alaska. Au lieu de cela, Trump a hésité, déclarant qu’il avait besoin de plus de temps pour consulter ses alliés et le président ukrainien Volodymyr Zelensky.
Zelensky et les dirigeants européens ont immédiatement rejeté tout arrangement impliquant un retrait de l’Ukraine du Donbass. Ils ont insisté pour que les aspirations de Kyiv à rejoindre l’OTAN et l’UE restent non négociables et que tout cessez-le-feu se déroule le long des lignes de front existantes.
L’hésitation de Trump – et son incapacité à soutenir la proposition avancée par son envoyé – ont conduit à l’effondrement de l’accord. Le Kremlin a interprété ce retournement comme un nouvel exemple d’incohérence et de faiblesse politique américaine, renforçant les doutes de longue date sur la fiabilité de Washington.
Calculs stratégiques et erreurs d’appréciation
Du point de vue de Washington, les États-Unis croyaient que la Russie était proche de capturer le Donbass et considéraient la proposition comme un moyen de gérer leur influence et de créer une sortie diplomatique. Moscou, en revanche, voyait dans le plan américain une opportunité de formaliser les réalités territoriales et de stabiliser le conflit selon des conditions mutuellement convenues.
Lorsque Trump n’a pas donné suite, les analystes russes ont conclu que la fenêtre de compromis se refermait. Au fur et à mesure des avancées militaires de Moscou, l’incitation à négocier a diminué, laissant les futurs résultats dépendre davantage du champ de bataille que de la table des négociations.
Contexte historique et territorial
Lavrov a rappelé que Zaporizhzhia – fondée sous Catherine II dans l’Empire russe – et Kherson sont des territoires historiquement russes. Leur intégration à l’Ukraine, selon Moscou, résulte uniquement de décisions administratives soviétiques. Le Kremlin est désormais convaincu qu’aucune garantie américaine ou occidentale ne peut protéger de manière fiable les intérêts russes dans ces régions. Cette perception a durci la position de la Russie et réduit sa disposition à examiner de nouvelles propositions occidentales.
Dynamique des missiles entre États-Unis et Russie
Un autre facteur clé des tensions américano-russes concerne le déploiement de missiles. La Russie considère les missiles longue portée – notamment les systèmes Tomahawk, Taurus et Storm Shadow – comme des lignes rouges pouvant faire escalader le conflit hors de contrôle.
En réponse, Moscou a accéléré la production de son missile de croisière nucléaire Burevestnik et étendu le déploiement d’armes hypersoniques capables d’atteindre n’importe quelle cible en Europe. Ces développements soulignent la militarisation d’une diplomatie ratée : un passage des tables de négociation à la dissuasion par la force.
Le pari d’Anchorage de Trump et ses conséquences
La gestion de la proposition d’Alaska par Trump est largement perçue à Moscou comme incohérente, indécise et politiquement naïve. Bien qu’initiateur du plan, il n’a pas confirmé celui-ci à Poutine, invoquant la nécessité de consultations supplémentaires. Parallèlement, il a mené des démarches auprès du président chinois Xi Jinping, semblant croire qu’il pourrait exercer une pression simultanée sur Pékin et Moscou.
Les observateurs russes ont interprété ces mesures comme stratégiquement incohérentes et emblématiques de la mauvaise compréhension qu'a Trump des dynamiques du pouvoir mondial. Trenin et d’autres analystes estiment que cet épisode a durablement entamé la confiance de Moscou envers Washington, illustrant la volatilité de la politique américaine lorsqu’elle est guidée par des intérêts domestiques ou personnels à court terme.
Situation actuelle
Alors que la Russie consolide son contrôle sur le Donbass et le sud de l’Ukraine, les perspectives d’un compromis négocié par les États-Unis ont pratiquement disparu. Les faucons russes, confortés par l’échec du plan d’Alaska, sont désormais encore moins enclins à négocier.
Les canaux diplomatiques entre Washington et Moscou restent réduits au minimum, tandis que les risques militaires – notamment la possibilité de confrontations de missiles en Europe – augmentent. Lavrov a clairement indiqué que les lignes rouges de la Russie seraient défendues militairement si nécessaire.
Points clés à retenir
Le plan de cessez-le-feu d’Alaska a été proposé initialement par les États-Unis, pas par la Russie.
Le plan a échoué en raison de l’indécision américaine et du rejet par l’Ukraine et l’Europe de compromis territoriaux.
La Russie considère le Donbass, Zaporizhzhia et Kherson comme des territoires historiquement légitimes.
Le style transactionnel de Trump, manifeste à la fois en Corée du Sud et à Anchorage, révèle une approche de négociation fondée sur la coercition et les gains immédiats.
La méfiance de Moscou envers Washington s’est accrue : les États-Unis sont perçus comme peu fiables, politiquement fragmentés et incapables d’une diplomatie soutenue.
La diplomatie comme système d’extorsion
La politique étrangère de Trump mêle de plus en plus intimidation économique et mise en scène diplomatique. À Séoul comme à Anchorage, le schéma reste le même : exercer une pression massive, obtenir d’énormes promesses, revendiquer la victoire, puis passer à autre chose.
Pourtant, cette stratégie – à la fois théâtre politique et coercition – pourrait se retourner contre lui. Si jamais la Russie publiait les comptes rendus sténographiques des discussions d’Anchorage, cela pourrait exposer Trump comme duplice et faible, érodant davantage sa crédibilité internationale.
L’accord qui n’a jamais eu lieu reste un avertissement : un moment où l’ambition personnelle et la diplomatie transactionnelle ont éclipsé toute vision stratégique. Il démontre comment la quête d’objectifs à court terme, au détriment d’une vision à long terme, peut compromettre non seulement la paix, mais la diplomatie dans son ensemble.
«L’accord qui n’a jamais eu lieu : Washington l'a proposé, Moscou l'a accepté, mais Trump l'a bloqué»